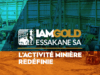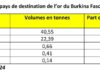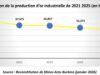L’Agence nationale des Évaluations environnementales (ANEVE) est la structure qui est chargée de mettre en œuvre l’ensemble des stratégies en matière d’évaluation environnementale au sein du Burkina Faso. Quelles sont les manquements récurrents en matière de non-respect de l’environnement ? Quelles sont les difficultés rencontrées par l’ANEVE et comment les surmonter ?Le directeur général de l’ANEVE, Alain P.K. Gomgnimbou, répond à cette question dans cette interview.
Mines Actu Burkina : Quels sont les manquements les plus récurrents dans le non-respect de l’environnement ?
Alain P.K. Gomgnimbou : Les manquements qui sont récurrents concernent la non-réalisation des évaluations environnementales avant implantation, des projets. La non-réalisation régulière des audits environnementaux selon les périodicités constitue aussi des manquements. Tant que l’on ne met pas la pression, une grande majorité des promoteurs de projets n’en font pas. Les autres manquements sont à rechercher du côté de la pollution qui porte atteinte l’environnement. Pollution à travers les rejets pour un projet qui émet des gaz, des fumées. Ces rejets constituent un problème même si le promoteur respecte les normes. Un autre manquement qui se situe au niveau du suivi est la difficulté d’établir d’indicateurs de la pollution. Cet exercice demande des moyens sophistiqués. Au-delà de la pollution de l’air, on a la pollution des eaux souterraines.
Quelles sont les sanctions prévues en cas de non-respect de l’environnement ?
Au titre des sanctions d’ordres administratives, on a la mise en demeure, ou des demandes de corrections des manquements. Prenez le cas d’une usine qui rejette ses eaux usées dans la nature alors que ses eaux usées devraient être collectées et traitées. Si l’usine n’a pas un dispositif de traitement, l’administration peut l’intimer d’aménager ce dispositif. Si l’activité est dangereuse avec des effets dommageables avérés, la sanction peut aller jusqu’au retrait des autorisations de pratiquer l’activité.
Des sanctions et amendes existent pour les projets de catégories A. Si un promoteur commence son activité sans une étude d’impact environnementale et social, il peut écoper d’une amande située entre 10 à 50 millions FCFA en plus de la réalisation de l’étude. L’amande peut être entre 1 à 5 millions FCFA quand le projet est de catégorie B où on retrouve les stations, les auberges, les unités d’emballages, etc. Si la structure est fonctionnelle, l’amande est située entre 500 000 à 2 millions FCFA en cas de manquement dans les audits environnementaux.
Quels sont les atouts dont l’ANEVE dispose pour le suivi du secteur minier ?
L’ANEVE dispose du cadre juridique et règlementaire existant. Aujourd’hui, tout est encadré par des textes bien élaborés qui permettent de faire ce suivi. Depuis 2020, l’ANEVE est une agence autonome avec des statuts particuliers et jouissant d’une autonomie administrative et financière qui lui permet en principe de pouvoir couvrir sa dimension nationale. C’est à elle de veiller à faire respecter les textes en matière d’évaluation de l’environnement. Également, l’ensemble des départements ministériels et les partenaires techniques et financiers apprécient l’ANEVE et comptent sur elle pour les questions de l’intégration des sauvegardes environnementales dans les projets.
Quelles sont les difficultés rencontrées par l’ANEVE et comment les surmonter ?
Les statuts l’ANEVE date de 2002 en tant qu’établissement public de l’État. Les textes sont toujours en relecture pour relever certaines insuffisances. Un meilleur ancrage et une meilleure représentativité au niveau des régions vont accélérer le traitement des dossiers.
Au niveau des ressources humaines, la question du personnel hautement qualifié sur certains domaines de métier se pose. L’ANEVE doit faire des efforts pour renforcer les capacités de ces agents pour faire face aux questions liées à l’environnement.
La réhabilitation des sites miniers n’est pas effective au Burkina Faso qu’elles sont les raisons, les impacts ?
C’est une réalité, mais à deux niveaux, historique et règlementaire. Les premiers projets miniers ont fermé au moment où il n’y avait peut-être pas de dispositions juridiques pour encadrer la question des réhabilitations. C’est le cas de la mine de Poura. De nos jours, le cadre règlementaire existe et institue même le fonds de réhabilitation et de fermeture des mines. Il nous appartient de prendre des dispositions pour que les mines en fin de vie puissent transmettre leurs plans de réhabilitation et de fermeture. C’est vrai qu’il y a des ajustements administratifs à faire pour notamment examiner ses plans qui sont soumis, mais ce sont des choses qui seront bientôt réglées. Si les mines ne sont pas réhabilitées, les effets néfastes vont perdurer et que nous courrons vers une catastrophe que nous n’accepterons pas à notre niveau. Les dégâts seront énormes en termes de pollution en termes d’atteinte biologique. C’est une grave menace pour certaines zones si ces sites ne sont pas réhabilités.
Avez-vous des recommandations à faire ?
L’ANEVE étant de l’Etat, nous devrions davantage continuer à jouer notre rôle pour faire appliquer les textes et être beaucoup plus regardant sur quelques aspects stratégiques comme la question de la réhabilitation qui reste un problème entier. À l’endroit des projets, c’est de s’assurer également de leur responsabilité sociétale vont vers des pratiques écologiques de gestion. Ils doivent respecter les règlementations en vigueur parce que la durabilité des projets ne peut se faire seulement sur les aspects économiques. Il faut conjuguer les aspects économiques, le social, mais aussi également la protection de l’environnement.
À l’endroit de la société civile, nous devons travailler à ce que ces acteurs soient impliqués dans ce processus. La société a une grande part de responsabilité et ls contribue à interpeler sur des manquements. Elles peuvent aussi être de bon relai au niveau régional et même local pour que certaines situations qui sont vécues dans certains sites puissent être relayées.
Quel est votre dernier mot ?
C’est surtout vous remercier pour l’initiative, elle nous donne une plage pour parler de nos activités. Il faut le respect des textes, il faut s’assumer sur les questions environnementales. Les effets sont visibles. Le changement climatique que nous ressentons d’une manière ou d’une autre est l’effet de nos propres activités. Il faut davantage interpeler sur les questions de l’environnement comme on le dit souvent on peut agir localement et penser globalement.
Interview réalisée par Rachid Ouédraogo
#Mines_Actu_Burkina