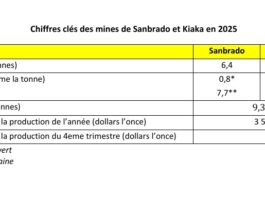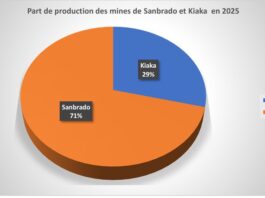Pour ce 2eme jour de la 7e édition de la Semaine des Activités Minières d’Afrique de l’Ouest (SAMAO) ce vendredi 26 septembre 2025, un panel a mis l’accent sur l’enjeu de transformer l’héritage environnemental des mines en opportunités pour les écosystèmes et les communautés. Pour Judicaël Ouédraogo, Directeur de l’Environnement pour la filiale de West African Resources, la restauration doit concilier le cadre légal national et l’adhésion des communautés locales.
Alors que l’exploitation minière reste un pilier économique pour de nombreux pays africains, notamment le Burkina Faso, la question de l’après-mine s’impose avec urgence.

En effet, le consensus est clair. La réhabilitation ne se limite plus à une obligation réglementaire. Elle incarne une responsabilité écologique et sociale, visant à restaurer non seulement les sols et l’eau, mais aussi le tissu socio-économique des régions concernées. Cette 7e édition de la SAMAO, a offert un cadre d’échange pour dresser un bilan sans concession des progrès accomplis, des obstacles persistants et des solutions innovantes pour une restauration véritablement durable.
Il a illustré son propos par l’exemple de la Société des Mines de Sanbrado (SOMISA S.A.), où 48 hectares d’anciens sites d’orpaillage illégaux et de dépôts de stériles ont été réhabilités. La stratégie mise en œuvre va au-delà du simple reboisement, a-t-il fait savoir. « Une caractérisation géochimique rigoureuse permet de prévenir le drainage minier acide, tandis qu’un encapsulage des résidus contenant des métaux lourds est systématiquement appliqué », a-t-il ajouté.
L’entreprise s’est également dotée d’une pépinière capable de produire 25 000 plants par an, assurant une revégétalisation adaptée et maîtrisée.

La science au service de la dépollution des sols…
Le Dr Hâdu Haro, Chef du département Environnement et Forêt à l’Institut de l’Environnement et de Recherches Agricoles (INERA), a pointé l’absence criante d’un référentiel national de réhabilitation.
Il a plaidé pour une approche scientifique afin d’éviter les solutions simplistes. « Planter des arbres sans analyser la contamination des sols est une démarche risquée. Certaines espèces bioaccumulent les métaux lourds, créant un danger pour la chaîne alimentaire », a-t-il mis en garde.
A l’en croire l’INERA explore des voies biotechnologiques prometteuses, comme la phytorémédiation. Cette technique utilise des plantes androgènes, associées à des champignons et microorganismes spécifiques, pour augmenter la tolérance des végétaux aux sols pollués et faciliter leur décontamination.
« La revégétalisation, qui vise un couvert végétal, n’est pas synonyme de réhabilitation, laquelle doit adresser la question de la pollution. La biomasse produite peut devenir un stock de polluants qu’il faut gérer avec précautions », a souligné Dr Haro.
Le Centre National de Semences Forestières (CNSF), représenté par le lieutenant-colonel José Bama, a présenté son rôle de partenaire technique clé. Fort de quatre décennies d’expérience, le centre fournit des semences d’espèces herbacées et ligneuses parfaitement adaptées aux conditions locales, un gage de succès pour la revégétalisation, selon José Bama.
Au-delà de la fourniture de semences, le CNSF mise sur le renforcement des capacités. « Notre action inclut un appui-conseil et des formations aux communautés riveraines des mines, garantissant que les savoir-faire en matière de réhabilitation s’ancrent durablement dans les territoires », a expliqué le lieutenant-colonel Bama.
Anne-Marie O.
#Mines_Actu_Burkina.