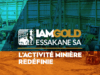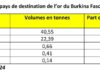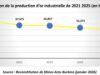Plusieurs types de conflits miniers rencontrés dans le secteur minier. Comment se manifestent-ils ? Quels sont les causes et les mécanismes de résolution ? Pour répondre à ces questions, Mines Actu Burkina est allé à la rencontre de Diakalya Traoré, Magistrat de profession, Substitut du Procureur général près la Cour d’appel de Bobo-Dioulasso, spécialisé dans la gestion du contentieux minier et plus globalement des conflits miniers. Il est en train de boucler une certification en droit minier et des hydrocarbures en Afrique à l’Institut québécois des Affaires internationales (IQAI) avec comme thème de recherche : « La dynamique des conflits miniers au Burkina Faso ».
Mines Actu Burkina : Quels sont les types de conflits miniers rencontrés dans le secteur ?
Diakalya Traoré : Il est aisé de constater, a priori, que l’instinct conflictuel n’est pas l’apanage exclusif du monde animal ; les humains ont tout aussi l’instinct grégaire conflictuel que la société animale. Malheureusement, la variable conflictuelle semble être l’un des oubliés de l’investissement minier. Ce n’est qu’à l’épreuve de la réalisation du projet minier que les investisseurs réalisent que la viabilité de la production minière est subordonnée à l’existence d’un climat social et professionnel apaisé.
Cela dit, menant des recherches sur les conflits miniers et pour avoir été médiateur-conciliateur bénévole dans la gestion de certains conflits miniers, à la demande des acteurs en présence, j’ai pu constater que la conflictualité dans le secteur minier burkinabè est très dynamique, se caractérisant ainsi par un enchevêtrement complexe et versatile articulé autour des problèmes d’empiètement des superficies couvertes par les permis des sociétés minières par des artisans miniers, les problèmes des compensations et indemnisations, les problèmes des rotations avec les travailleurs, etc.
Néanmoins, géométriquement, l’on peut procéder à une classification catégorielle artificielle selon les parties en conflit ou l’objet du conflit.
Selon les parties en conflit, l’on dénombre 3 catégories de conflictualité dans le secteur minier, en l’occurrence, la conflictualité verticale, la conflictualité horizontale et la conflictualité diamétrale ou transversale (lire encadré).
Selon l’objet du conflit, il est possible d’identifier 4 catégories de conflits en se fondant sur leur fréquence : les conflits liés aux indemnisations et compensations ; les conflits liés à la règlementation du travail (rotations, heures supplémentaires) ; les conflits liés à l’occupation spatiale ; les conflits liés aux titres miniers (octroi et retrait, retrait et réattribution) ; les conflits liés à l’exploitation par procuration (stratégie de la marionnette intelligente).
Cette dernière catégorie qu’on observait de loin dans d’autres pays africains, est en pleine expansion dans notre pays ces dernières années. Ces conflits surviennent lorsque des sociétés étrangères ou des individus qui n’ont aucune autorisation ou aucun permis d’exploitation minière exploitent tout de même les ressources minières du pays par l’intermédiaire des artisans miniers qui possèdent des autorisations d’exploitation artisanale ou qui n’en possèdent même pas du tout. En d’autres termes, il s’agit des conflits liés à l’exploitation frauduleuse (extraction illégale) de l’or par des étrangers le plus souvent et des nationaux souvent.
Quelles sont les manifestations de ces conflits miniers ?
Empiriquement, les conflits miniers se manifestent de manière ouverte ou latente, violente ou non violente. Le conflit est latent lorsqu’il n’alerte pas l’opinion publique sur sa survenance ou son existence. Il est verrouillé entre des acteurs internes de la chaîne de l’exploitation minière, impliquant souvent des communautés riveraines. Il est facilement remarquable à travers la multiplication des rencontres, des cadres de concertations multi-acteurs et la production des correspondances sous forme de plaintes à destination des autorités administratives locales et nationales. Le conflit est ouvert lorsqu’il échappe au règlement de la diplomatie de couloir pour bourdonner au grand jour, s’attirer l’attention de l’opinion, parfois par voie médiatique. A ce stade, il peut être violent ou non violent.
Le conflit minier est non violent dès lors qu’il se résume par des grèves des travailleurs (arrêt de travail), des meetings, des sit-in, des marches pacifiques ou des assemblées générales. Par ailleurs, le conflit minier non violent est celui qui se manifeste aussi par la multiplication et la démultiplication des procédures judiciaires, souvent intempestives, souvent à des fins d’intimidations, des sanctions disciplinaires telles que des mises à pied, des lock-out, allant parfois aux licenciements.
Le conflit minier est violent lorsqu’il signale sa présence par des coups et blessures volontaires, des séquestrations des responsables de la mine ou certains de ses employés, des coups mortels ou homicides, des incendies des meubles et immeubles de la mine ou du personnel minier, des blocages imposés des activités d’exploitation et toutes sortes d’actes de vandalisme.
Quelles sont les causes de ces conflits miniers ?
Il y en a plusieurs, mais je vais m’en tenir à 5 seulement :
La première cause qui semble être congénitalement la mère biologique des conflits miniers est la libéralisation à outrance de l’exploitation des ressources minières. Le coup détonateur de cette option idéologique a été l’adoption par le gouvernement burkinabè des Programmes d’ajustement structurel (PAS), lors du Conseil des ministres en date du 20 novembre 1990, dans un contexte international marqué par la mort proclamée du socialisme, la chute du mur de Berlin marquant théoriquement la fin de la guerre froide, le discours de la Baule et les injonctions des institutions de Breton Woods…
L’argumentaire officiel qui avait prévalu à cette option idéologique du gouvernement à l’époque était que les PAS constituent « un tremplin pour le développement global et harmonieux, au bénéfice d’une société nouvelle où nos masses populaires trouveront la satisfaction de leurs besoins et de leurs aspirations fondamentales ». Ce pour quoi, les différents Codes miniers qui se sont succédé (1997, 2003, 2015 et 2024) sont taillés à l’image du cadre systémique des PAS qui ont pourtant produit des résultats illusionnistes s’il était permis de faire un bilan de 1990 à nos jours (juillet 2024). Le constat indéniable qui s’impose est que le Burkina Faso a opéré une mutation matérialisée par le passage de l’étatisation à la désatisation, c’est-à-dire, la privatisation, de l’exploitation minière industrielle, avec en filigrane la possibilité pour les investisseurs privés qui sont en réalité, pour la plupart, les firmes multinationales, de désacraliser des lieux sacrés, d’exproprier les populations locales, les paysans, les éleveurs, les habitants, etc. ; ce qui va naturellement de pair avec des révoltes populaires contre les sociétés minières !
La deuxième cause est relative à l’approche législative en matière d’exploitation minière qui est foncièrement conflictogène, à l’image de l’approche politique en matière de gouvernance minière qui est profondément schizophrénique. D’un côté, vous avez un Etat burkinabè qui est affirmatif sans équivoque sur ses intentions souverainistes vis-à-vis de ses ressources naturelles qui doivent servir à l’amélioration des conditions économiques et sociales de son peuple. L’article 14 de la Constitution du 11 juin 1991 n’énonce pas autre chose en précisant que « les richesses et les ressources naturelles appartiennent au peuple. Elles sont utilisées pour l’amélioration de ses conditions de vie ». De l’autre, vous avez une règlementation minière qui fait la part belle, de fait et de droit, aux entreprises privées en positionnant l’Etat comme un simple instrument de régulation. La conséquence logique d’une telle approche est la disproportionnalité entre la richesse du sol et du sous-sol en ressources minières et la pauvreté, voire la misère honteuse des populations riveraines et, partant, du peuple ! Ce qui développe en saine logique l’élan conflictuel des communautés riveraines à l’encontre des mines industrielles. La situation est encore pire en ce qui concerne les artisans miniers, eux qui sont généralement les premiers explorateurs, les premiers chercheurs, les premiers exploitants mais qui seront toujours les premiers déguerpis dès lors qu’un permis d’exploitation industrielle viendrait postérieurement à couvrir la superficie qu’ils occupent. Les articles 71, 72 et surtout 73 du Code minier de 2015 consacraient une telle situation conflictuelle. L’article 91 du Code minier adopté le 18 juillet 2024 semble y donner un palliatif en prévoyant la faculté pour le/la titulaire du permis d’exploitation industrielle de concéder au moins 10% du capital social à l’artisan minier et, à défaut, l’indemniser. La conflictualité demeure toujours entre les mines industrielles et les orpailleurs sur l’occupation des mêmes espaces autorisée par l’administration minière à ces deux acteurs aux intérêts contradictoires !
La troisième cause des conflits est l’absence d’un référentiel légal d’indemnisation des personnes affectées par le projet minier de sorte qu’il y a une disparité entre les quanta des indemnisations d’une mine industrielle à une autre. Certaines mines dédommagent un (01) hectare agricole à plus de 2.000.000 FCFA, tandis que d’autres sont à moins de 1.000.000 FCFA ; certaines indemnisent un plant à 15.000 ou 30.000 FCFA, tandis que d’autres le font à 80.000 FCFA.
La quatrième cause est l’absence d’une législation de travail spécifique au secteur minier, alors que le Code du travail de 2008 en cours de relecture ne prend pas en charge toutes les questions sectorielles. Il aurait fallu une convention collective sectorielle régissant les horaires de travail, les heures supplémentaires, les rotations du personnel, etc. La possibilité de recourir aux accords d’établissement qui se matérialise par des protocoles d’accord n’est toujours pas viable, car certains employés tiennent à l’application de principe du Code du travail, pendant que le minier industriel souhaite une production permanente, surtout lorsque le coût de l’or est valorisé.
La cinquième cause est imputable aux attitudes de certaines sociétés minières qui s’illustrent par l’insuffisance de communication, la défaillance de leur dispositif interne de gestion des plaintes ou encore la non-tenue des promesses.
Avez-vous évalué l’ampleur des dégâts causés par ces conflits ou certains conflits ?
Je n’ai jamais procédé personnellement à l’évaluation des dégâts dus à un conflit minier. Cependant, de l’avis des acteurs, notamment, des sociétés minières, les dégâts matériels, ainsi que les préjudices liés à l’arrêt de travail du fait d’un conflit s’élèvent le plus souvent à plusieurs milliards FCFA. Par exemple, un des responsables de la mine de Houndé (HGO) a confié, lors d’un atelier, que l’arrêt de travail d’une journée causait des pertes financières estimées à 600 millions FCFA ; il a ajouté que le préjudice financier des 11 jours d’arrêt de travail dû au mouvement d’humeur des employés de HGO, courant janvier-février 2024, s’élevait à 7 milliards FCFA.
Quels sont les mécanismes de résolution les plus rencontrés ?
Classiquement, les modes juridictionnels de résolution des conflits sont les plus usités, à savoir les recours aux tribunaux burkinabè, à la médiation ou à l’arbitrage devant le CAM-CO (Centre d’arbitrage, de médiation et de conciliation de Ouagadougou) ou la CIC-P (Chambre internationale de commerce de Paris). Il faut, toutefois, préciser que le recours fréquent à un mécanisme varie en fonction de l’objet du conflit.
Selon vous, existe-t-il d’autres mécanismes de résolution ?
Oui, il existe d’autres mécanismes de résolution des conflits. Je profite de votre micro pour faire constater que les sociétés minières industrielles, de même que les artisans miniers, ont psychologiquement la méfiance vis-à-vis des recours judiciaires et la préférence pour les règlements amiables. A entendre les acteurs du secteur minier, le dénouement de l’affaire de la mine de zinc de Perkoa semble avoir créé un traumatisme chez plusieurs sociétés minières. C’est pourquoi, le choix de la transaction fait par le gouvernement dans l’affaire charbon fin a été très bien accueilli par beaucoup d’entre elles ; or, un tel choix n’est pas du goût des organisations de la société civile (OSC) de lutte contre la corruption, notamment, le Réseau national de Lutte anti-corruption (REN-LAC), qui pense que si transaction il y a, pour plus de transparence, il faut au préalable des débats nourris au prétoire du juge, afin de dévoiler à l’opinion les modes opératoires des multinationales minières.
Au-delà de la transaction, il existe des mécanismes ‘’émergents’’ développés par les parties prenantes, avec souvent l’accompagnement de l’Etat, à travers les autorités administratives locales. Il s’agit des services de gestion interne des plaintes qui existent dans presque toutes les sociétés minières ; il s’agit des dispositifs mis en place par les mines industrielles pour recevoir les plaintes des communautés locales affectées par l’investissement minier ; des Comités de suivi et de liaison (CSL) qui sont en réalité des cadres de concertation multi-acteurs regroupant les représentants de l’administration de la mine, des collectivités territoriales, des autorités administratives départementales ou provinciales ou souvent même régionales, des représentants de la jeunesse, des OSC, des autorités coutumières et parfois religieuses, etc.
Interview réalisée par Elie KABORE
Encadré 1
3 catégories de conflictualité dans le secteur minier
- La conflictualité verticale est celle qui oppose habituellement :
– les institutions de l’Etat aux institutions de l’Etat (conflits positifs de compétences dans le domaine minier) ;
– les sociétés minières à l’Etat ;
– les sociétés minières aux sociétés minières (autres sociétés minières ou filiales contre les groupe-mères) ;
– les sociétés minières aux sociétés de sous-traitance ;
– les sociétés minières à d’autres sociétés commerciales (par exemple, société d’assurance ou de transit) ;
– etc.
- La conflictualité horizontale caricature les conflits opposant fréquemment :
- les sociétés minières aux communautés locales affectées par le projet minier ;
- les sociétés minières aux artisans miniers ;
- les sociétés minières à leurs travailleurs ;
- les communautés locales aux communautés locales (exploitants et propriétaires terriens) ;
- les communautés locales aux artisans miniers ;
- les artisans miniers aux artisans miniers ;
- La conflictualité diamétrale ou transversale est celle qui mobilise toutes les parties prenantes, y compris l’Etat et ses démembrements. Elle s’identifie le plus souvent dans les domaines :
– des infractions minières ;
– des conflits liés à la violation des droits coutumiers ;
– des conflits liés à la mise en œuvre de la RSE ;
– des conflits liés à la mise en œuvre du contenu local.
Encadré 2
Merci, Monsieur Elie Kaboré, de votre intérêt pour la problématique des conflits miniers, en particulier, et en général, pour les questions liées à l’exploitation minière au Burkina Faso, en Afrique et partant, dans le monde. Avant de répondre à votre question, permettez-moi de vous féliciter pour tous vos efforts dans le sens d’informer l’opinion publique nationale et internationale sur l’actualité minière, notamment, avec le journal Mines Actu. Votre expertise en la matière est appréciée au-delà des frontières du continent africain.