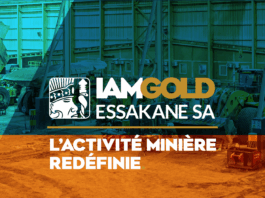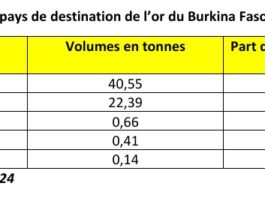Diachroniquement, la législation minière burkinabè est marquée par une évolution symétrique et quadrigonale se caractérisant par quatre (04) empreintes épisodiques.
La première empreinte griffée de la coloration coloniale couvre l’épisode d’avant l’indépendance du pays jusqu’en 1965 avec le décret n°54-1110 du 13 novembre 1954 portant réforme du régime des substances minérales dans les territoires d’Outre-mer, modifié en 1955, puis en 1957.
La deuxième est une esquisse de décolonisation législative pour entamer un processus de souveraineté juridique avec l’avènement de la loi n°09/65/AN de juin 1965 portant régime des substances minérales en Haute-Volta, à l’exception des hydrocarbures liquides ou gazeux. Cette loi était expressive d’une gomme purgatoire du régime juridique des substances minérales en Haute-Volta de sa phraséologie coloniale et, inversement, dessinait l’étatisation de l’exploitation des ressources minérales. Sous son emprise, l’Etat burkinabè mettra en place la SOREMIB pour exploiter ses ressources minières.
La troisième empreinte est dictée par l’Ordonnance n°76-010/PRES/MCDIM/DGM du 22 juin 1976 portant régime des substances minérales extraites du sol et du sous-sol en Haute-Volta.
Après une séquence d’hémiplégie législative, la quatrième empreinte a surgi avec sa spécificité, surtout avec son instabilité, en ce sens qu’elle vacille aux confluents des impératifs antagoniques d’attractivité du secteur minier et de quête de souveraineté de l’État sur ses ressources minières.
En effet, depuis 1991, le Burkina Faso s’est engagé dans un long processus de libéralisation de son secteur minier, avec pour ambition d’en accroître l’attractivité à l’endroit des investisseurs étrangers. Cette orientation stratégique s’est matérialisée par l’adoption successive de quatre Codes miniers – en 1997, 2003, 2015 et, tout récemment, le 18 juillet 2024 – chacun répondant aux exigences contextuelles du moment.
1997 : Le Code minier de 1997 marque une rupture avec le monopole d’État sur l’exploitation des ressources naturelles, initiant ainsi l’ouverture du secteur à des opérateurs privés, en dehors de l’activité artisanale des orpailleurs.
2003 : Face aux réserves exprimées par certaines institutions financières internationales et à la prudence des firmes minières étrangères, le Code minier de 2003 visait à rendre le secteur davantage compétitif et attractif, afin de stimuler les investissements directs étrangers.
2015 : Adopté dans un contexte post-insurrectionnel, le Code minier de 2015 a été pensé comme un instrument de renforcement de la justice économique. Il introduit plusieurs innovations : création de fonds miniers dédiés aux communautés locales, à la recherche, à la réhabilitation des sites miniers, et réforme de la fiscalité minière, avec pour objectif de maximiser les retombées financières au profit de l’État et des populations.
2024 : Le Code minier du 18 juillet 2024 intervient dans un contexte national particulièrement complexe, marqué par :
– Une crise sécuritaire prolongée, engendrant une pression humanitaire et budgétaire croissante ;
– Une montée des revendications souverainistes et des discours anti-impérialistes sur les ressources naturelles ;
– Des tensions sociales accrues autour des activités minières (affaire « charbon fin », fermeture dramatique et inattendue de la mine de Perkoa suite à une décision judiciaire condamnant ses responsables, consécutive à une inondation, conflits entre sociétés minières, orpailleurs et communautés locales) ;
– un besoin impérieux de mobilisation des ressources internes pour soutenir les charges publiques.
Dans ce contexte, la réforme de 2024 tente de concilier deux exigences apparemment contradictoires :
1. Renforcer la souveraineté de l’État et améliorer les retombées locales de l’exploitation minière ;
2. Maintenir l’attractivité du secteur pour les investisseurs internationaux, tout en favorisant l’émergence d’un capital national minier.
Ce pour quoi, parmi les objectifs majeurs de cette réforme figurent :
– La valorisation locale de la production minière ;
– L’intégration accrue des nationaux dans les chaînes d’exploitation ;
– le renforcement de la gouvernance minière et du contrôle public du secteur minier ;
– La structuration du secteur de l’orpaillage ;
– la responsabilisation accrue des entreprises minières, tant sur le plan fiscal, environnemental que social.
L’évolution du droit minier burkinabè illustre ainsi la complexité d’un équilibre à atteindre entre logique de marché et impératif de souveraineté. Une équation dont la résolution reste inachevée par le législateur. Pour ne pas rester insoluble, sa résolution nécessite la mobilisation des réflexions alliant l’ingénierie juridique aux impératifs économiques et aux choix politiques.
Diakalya TRAORE, Certifié en droit minier