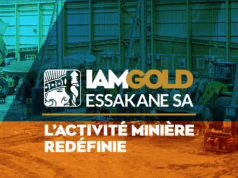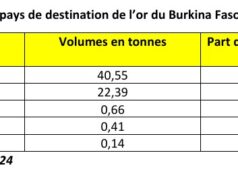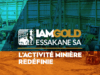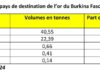Alizèta Ouédraogo est Docteure en Sociologie et Anthropologie. Elle est également chercheure (Attachée de Recherche) à l’Institut de Recherche en Sciences de la Santé (IRSS) du Centre National de Recherche Scientifique et Technologique (CNRST) au Burkina Faso. Elle est reconnue comme experte senior en développement social, environnemental et genre. Elle cumule plus de dix ans d’expérience en recherche et coordination de projets. Son parcours académique l’a permis d’acquérir une compréhension approfondie des dynamiques sociales et de leurs interconnexions cruciales avec la santé communautaire. Ses compétences techniques s’étendent à l’expertise des exploitations minières (qu’elles soient artisanales ou industrielles), à la gestion des conflits fonciers et à la sauvegarde du patrimoine culturel dans le cadre des projets miniers. Parallèlement, elle enseigne dans des universités publiques, notamment le module de la Gouvernance des Ressources Naturelles. Elle est membre associée du Laboratoire Genre et Développement de l’Université Joseph Ki-Zerbo, et Secrétaire générale de l’Association des Femmes scientifiques du Burkina Faso (AFSciB), ainsi que membre de l’Association Women In Nuclear.
Comment êtes-vous arrivée dans le secteur minier ?
Mon parcours dans le secteur minier a débuté en 2012, marquant mon premier contact avec le monde de l’exploitation minière artisanale et à petite échelle, couramment appelé « orpaillage ». J’ai alors rejoint une ONG nationale en tant qu’assistante de recherche dans le cadre d’un projet sur l’amélioration de la performance environnementale et sociale de l’orpaillage dans la région du sud-ouest du Burkina Faso, avec pour mission de co-évaluer les impacts environnementaux et sociaux des sites aurifères. Une fois sur le terrain, j’ai été frappée par une réalité inattendue. Contrairement aux idées reçues et à la littérature qui décrivait un secteur majoritairement masculin, j’ai découvert une présence significative et un rôle primordial des femmes tout au long de la chaîne opératoire de l’or. Elles occupaient et occupent toujours des positions cruciales, de la prospection à la commercialisation, en passant par le traitement du minerai. Cette observation a clairement révélé l’importance des rapports sociaux de genre dans ce domaine.
Cette découverte a été une révélation et une source de motivation intense pour moi. Cela m’a poussée à approfondir mes recherches sur l’exploitation minière artisanale et à petite échelle et les rapports de genre, d’abord en Master 2 recherche en anthropologie, puis avec un doctorat en sociologie et anthropologie, soutenus respectivement en 2014 et en 2021. Ma thèse, intitulée « De l’anthropologie de l’orpaillage au féminin à la santé maternelle et infantile sur les sites d’orpaillage » qui s’inscrit dans la continuité de mon mémoire de master 2 m’a permis d’étudier les impacts sanitaires des nouvelles dynamiques sociales sur les mères et les enfants sur les sites aurifères. Mon expérience dans le secteur minier s’est enrichie avec mon passage dans une compagnie minière industrielle au Burkina Faso entre 2014 et 2016. Pendant cette période, entre mon Master 2 et ma thèse, j’ai découvert une autre forme d’exploitation minière où je travaillais spécifiquement sur les questions d’impact environnemental et social. Chargée de la gestion des plaintes et des litiges du projet minier, je m’occupais de la compensation des biens du patrimoine culturel : des mosquées, des églises, des lieux ou collines sacrés ou l’on fait des sacrifices, des bosquets, des cimetières… des questions de relocalisation des biens culturels déplaçables. J’ai aussi participé à la mise en œuvre d’un plan de restauration des moyens de subsistance, en y intégrant la dimension de genre pour tenir compte de l’impact des activités minières industrielles sur les femmes. J’ai eu l’opportunité de travailler pour un cabinet d’ingénierie sociale au cours de ma thèse, ce qui m’a permis de bénéficier du programme NORFACE sur l’un de ses projets : « GOLD MATTERS – Sustainability Transformations in Artisanal & Small-Scale Gold Mining : Une perspective multi-acteurs et transrégionale ». Dans ce cadre, j’intervenais en tant que doctorante et chercheure associée sur les questions de durabilités et d’évolution des techniques dans l’exploitation minière artisanale et a petite échelle au Ghana et au Burkina Faso. Après mon doctorat, j’ai rejoint le milieu des ONG où j’ai coordonné un projet national sur l’Exploitation Minière et à Petite Échelle et les problèmes de santé liés au mercure. J’ai plusieurs publications scientifiques sur le secteur minier et très engagée, ce qui m’a valu une attestation de reconnaissance et un prix spécial lors de la Journée de l’Artisan Minier (JAM) en 2023, décernés par le Ministère de l’Énergie, des Mines et des Carrières du Burkina Faso. L’Office National de Sécurisation des Sites Miniers (ONASSIM) m’a également remis un certificat de reconnaissance pour mon soutien à leur Office.
Selon vous, quelles sont les difficultés que rencontrent les femmes dans ce milieu ?
La présence des femmes dans le secteur minier burkinabè, qu’il s’agisse de l’artisanat ou de l’industrie, est indéniablement en croissance. Cependant, cette augmentation de leur implication met en lumière un ensemble complexe de défis qui vont bien au-delà des simples considérations économiques ou techniques. Ces difficultés, profondément enracinées dans des contextes socio-économiques et culturels, entravent leur pleine participation et leur bien-être. Il faut bien reconnaître que le secteur minier demeure largement masculin. Les stéréotypes de genre sont tenaces ; par exemple, l’idée que le creusage n’est «pas fait pour les femmes» les cantonne souvent à des tâches moins valorisées et peu rémunérées, comme le concassage manuel, le transport ou le lavage du minerai. Cette division du travail engendre des inégalités salariales marquées. De plus, dans l’orpaillage artisanal, leur accès limité au financement et aux équipements modernes maintient nombre d’entre elles dans une situation de vulnérabilité économique, même si ce sont de véritables battantes, des entrepreneuses qui soutiennent financièrement leurs familles. Aussi, ces sites sont malheureusement aussi des environnements où la violence basée sur le genre (VBG), le harcèlement sexuel et la prostitution persistent. Le simple «statut de femme» peut devenir un handicap, exigeant de développer des stratégies personnelles pour éviter les sollicitations et préserver son intégrité. Côté conditions de travail, on peut observer des inégalités de salaire ou de traitement. Il n’est pas toujours simple de concilier le travail avec la vie de famille, surtout que les sites miniers que ça soit artisanal ou industriel sont souvent éloignés et exigent beaucoup de temps.
Avez-vous des propositions de solutions au profit des femmes ?
Face aux défis rencontrés par les femmes dans le secteur minier, il est crucial d’agir sans attendre. Nos efforts doivent se concentrer sur plusieurs axes pour garantir leur pleine participation et bien-être.
Il est d’abord essentiel de renforcer les capacités des femmes grâce à des formations techniques, entrepreneuriales et en gestion. Il faut aussi faciliter leur accès au financement et aux équipements modernes, surtout pour celles qui travaillent dans l’artisanat. Favoriser la structuration en coopératives et soutenir leur formation renforcera également leurs compétences et leur organisation. Nous devons aussi lutter fermement contre les violences basées sur le genre (VBG) et le harcèlement. Cela passe par la mise en place de mécanismes de plainte accessibles et des campagnes de sensibilisation généralisées. Il est également important de promouvoir des politiques inclusives dans les mines industrielles, avec des objectifs clairs de recrutement et de promotion pour les femmes. Pour assurer une participation équitable, nous devons soutenir le leadership féminin en renforçant les associations, coopératives et réseaux de femmes minières, et en veillant à ce qu’elles aient leur place aux tables de décision. Il est aussi impératif de mettre en œuvre des politiques minières sensibles au genre qui tiennent compte de leurs réalités spécifiques. De plus, il faut promouvoir activement les technologies minières sans produits chimiques nocifs pour réduire l’impact environnemental et sanitaire sur les femmes et les communautés. Enfin, une implication active et concertée de toutes les parties prenantes – gouvernements, communautés, organisations de la société civile et expert.e.s – est indispensable pour élaborer et mettre en œuvre des solutions durables et inclusives.
Avez-vous un dernier mot ?
Pour que les femmes trouvent pleinement leur place dans ce secteur en croissance, il est fondamental de reconnaître et de valoriser leur contribution. Cela exige des efforts concertés pour lever les barrières structurelles et culturelles qui subsistent. C’est ainsi que nous garantirons une réelle équité et libérerons tout le potentiel de ces actrices clés pour le développement de notre nation. Ainsi, mon souhait est d’apporter mes connaissances à ce secteur pour aider à résoudre ces questions cruciales, contribuant ainsi à la santé et au développement durable du pays. En conclusion, bien que les femmes du secteur minier burkinabè soient des figures résilientes et économiquement dynamiques, leur parcours est semé d’obstacles structurels, sanitaires, socioculturels et institutionnels. Ces défis exigent une attention et des actions ciblées pour garantir leur dignité, leur pleine participation et leur autonomisation.
PB
#Mines_Actu_Burkina